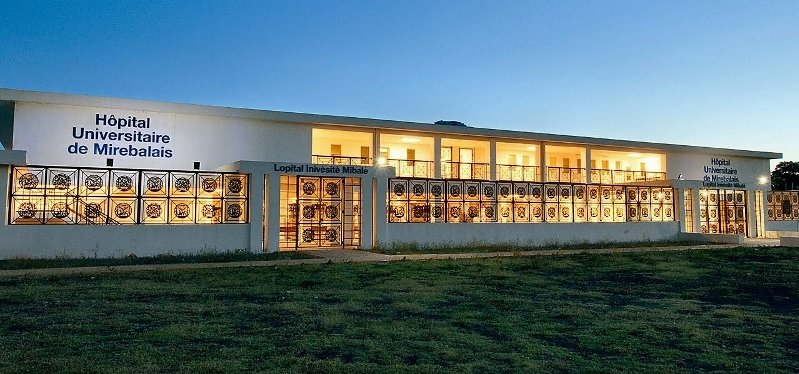Alors que plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes investissent pour rendre leurs systèmes de santé plus résilients face aux crises, Haïti lutte simplement pour la survie du sien.
Le contraste est saisissant. En République dominicaine, des hôpitaux modernisés ouvrent leurs portes chaque année. À Cuba, la médecine communautaire, malgré le manque de ressources, maintient une couverture nationale. Au Costa Rica, l’accès universel aux soins primaires est un droit fondamental.
Pendant ce temps, à Port-au-Prince, seuls 36 % des hôpitaux sont encore opérationnels. Beaucoup ont été incendiés, pillés ou abandonnés, laissant des millions d’Haïtiens sans accès aux soins les plus élémentaires. L’Hôpital Universitaire La Paix, encerclé par des camps de déplacés et des quartiers sous contrôle de gangs, est devenu l’ultime refuge hospitalier public de la capitale. En 2024, il a enregistré plus de 20 000 urgences, soit une hausse de 43 % en un an. Pourtant, faute de financement, 90 % de son personnel d’urgence risque d’être licencié d’ici novembre.
Cette crise découle directement de la fin d’un programme de financement de 55 millions de dollars lié à la COVID-19. Sans sa prolongation, des centaines de médecins et d’infirmières perdront leur emploi.
Alors que le pays avait presque éradiqué le choléra, la dégradation de l’accès à l’eau potable provoque la résurgence de l’épidémie. Plus de 3 100 cas suspects ont été signalés cette année, dont plusieurs décès récents à Pétion-Ville. Un scénario inimaginable à quelques kilomètres de là, en République dominicaine, où l’approvisionnement en eau potable est garanti par des politiques de santé publique. Le directeur de l’OPS, Jarbas Barbosa, prévient : « Si les services de santé continuent de s’effondrer, des centaines de milliers d’Haïtiens chercheront ailleurs les soins qu’ils ne trouvent plus chez eux. »

Ce message doit alerter la région, car un effondrement sanitaire en Haïti ne serait pas seulement une tragédie nationale : il représenterait une menace directe pour la stabilité sanitaire des Caraïbes et du continent.
En effet, pour sortir de cette impasse critique, plusieurs solutions concrètes pourraient être mises en œuvre.
Il serait d’abord possible de créer un fonds régional d’urgence, piloté conjointement par l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) et la CARICOM, afin de garantir la rémunération du personnel soignant haïtien et d’éviter l’hémorragie des compétences.
Parallèlement, il est envisageable d’établir un corridor humanitaire sanitaire, qui serait sécurisé par les Nations Unies, pour assurer l’acheminement vital des médicaments et des équipements médicaux vers les hôpitaux qui en ont cruellement besoin.
Une autre piste consisterait à développer des cliniques mobiles pour atteindre les populations isolées dans les zones enclavées, en s’inspirant du modèle qui a fait ses preuves au Honduras après l’ouragan Mitch.
Enfin, malgré un contexte diplomatique parfois tendu, il serait judicieux de mettre en place une coopération sanitaire transfrontalière avec la République dominicaine, notamment pour renforcer la surveillance et la réponse commune face aux épidémies.
Alors que ses voisins s’inquiètent des futures pandémies, Haïti vit déjà la sienne : une combinaison explosive de violence, de pauvreté et de maladies évitables. Le contraste est brutal : ailleurs, on cherche à se protéger de demain ; en Haïti, on tente de survivre aujourd’hui.
La question n’est plus de savoir quand investir, mais si la communauté régionale est prête à agir avant que le système de santé haïtien ne disparaisse complètement.